2013 年广东暨南大学法语考研真题
学科、专业名称:英语语言文学、外国语言学及应用语言学
考试科目代码与名称:280 法语
考生注意:所有答案必须写在答题纸(卷)上,写在本试题上一律不给分。
I. Choisissez la bonne réponse. (20 points)
1. Qu’est-ce que vous pratiquez
sport
?
A
: un
B
: comme
C
: pour
D
: par
2.-Vous envoyez des messages en e-mail à vos amis
?
- Oui, je
envoie souvent.
A
: en leur
B
: les leur
C
: leur y
D
: leur en
3. Les petites fleurs oranges
je pense fleurissent de mai à octobre.
A
: auxquelles
B
: à qui
C
: dont
D
: desquelles
4. Ces livres ne sont pas
que j’avais choisis.
A
: celui qui
B
: tous ceux qui
C
: celles-ci
D
: ceux
5. Ton frère
réussir s’il faisait un effort.
A
: puisse
B
: pouvait
C
: pourrait
D
: pourra
6. On fait tout
les enfants se sentent bien à l’école maternelle.
A
: pour
B
: pour que
C
: grâce à
D
: afin de
7. C’est
film de l’année.
A
: le mieux
B
: mieux
C
: le meilleur
D
: meilleur
8. S’il fait beau, on
sur la terrasse.
A
: mangeait
B
: mange
C
: mangerait
D
: mangera
1
�
9. C’est une maladie qui est difficile
guérir.
A
: à
B
: de
C
: pour
D
:en
10.
nombreux cours d’eau parcourent en France.
A
: Des
B
: Du
C
: De la
D
: De
11. La circulation au centre ville
à cause de la pollution.
A
: a été interdit
B
:
a
été
C
: a interdite
D
: interdite
interdite
12. Tu n’as pas envie
une petite sieste
(午休)?
A
: que tu fasse
B
: de faire
C
: qu’on ferait
D
: à faire
13. Elle fait de la gymnastique
les matins.
A
: tous
B
: toute
C
: tout
D
: toutes
14. J’ai oublié les dossiers, mais je
apporterai demain.
A
: lui les
B
: les vous
C
: me les
D
: te les
15. Hier, Stéphanie
la télévision quand Paul
.
A
C
: regardait, arrivait
: a regardé, est arrivé
B
D
: regardait, est arrivé
: est regardé, a arrivé
16.
ne me plaît pas du tout, c’est que tu prennes mes affaires sans me le
demander.
A
: Qu’est-ce que
B
: Ce que
C
: Ce qui
D
: Qu’est-ce qui
17. Bien que je
parler français, je n’ai aucune occasion de le parler dans
mon travail.
2
�
A
: sais
B
:
savais
C
: sache
D
: ai su
18. Ses parents sont sévères alors que
sont indulgents (宽容的).
A
: les tiennes
B
: tienne
C
: les tiens
D
: tiens
19. Je te déconseille le menu à 10 euros. En revanche,
du jour est excellent.
A
: le plat
B
: le repas
C
: l’ordre
D
: le restaurant
20. Si vous ne m’aviez pas prévenu, je
chez moi.
A
: sera resté
B
: resterais
C
: serais resté
D
: est resté
II. Compréhension écrite
: lisez les textes suivants et répondez aux questions.
Pour chaque question, on vous propose quatre réponses, une seule convient. (20
points)
Texte I
Un individu ayant à lire un texte dans une langue qu’il connaît mal aura la réaction
suivante : «
Je ne peux pas lire ce texte, je ne comprends pas certains mots
».
En effet, l’obstacle à la compréhension est en partie dû à une faible connaissance
du vocabulaire. Est-ce à dire qu’avec un dictionnaire, on parviendrait à comprendre
le
texte en cherchant la traduction de la plupart des mots
? Certes, il y aura un
résultat après de gros effets, cependant il faut se souvenir que la compréhension
d’une langue n’est pas seulement liée à la traduction d’une suite de mots, mais
à la perception (理解) des relations qui existent entre ces termes.
Devant un mot inconnu, le lecteur dispose de plusieurs moyens pour comprendre
:
- Le mot est compris selon le texte. Le lecteur utilise le sens de la phrase
pour deviner le mot inconnu.
- Le mot est découpé en unités plus petites. Le lecteur reconnaît dans le mot
quelque chose qu’il a déjà lu. Il voit «
courage
» dans le découragement
3
�
et comprend grâce à sa connaissance de la valeur de «
dé
».
- Le mot est reconnu grâce à la présence d’un élément
: photo, dessin et image.
- Le mot est compris à l’aide de la connaissance du vocabulaire ou d’un
dictionnaire.
Il faut encourager le lecteur à compter sur le texte pour lui donner le sens
d’un mot.
1. Ce document est destiné
A. seulement aux étudiants.
B. seulement aux professeurs.
C. à tous ceux qui veulent lire en langue étrangère.
D. à tous ceux qui lisent à l’aide d’un dictionnaire.
2. L’auteur du document
A. encourage les lecteurs à lire davantage.
B. encourage les lecteurs à lire en traduisant le texte mot à mot.
C. montre comment comprendre facilement un texte.
D. montre comment mieux utiliser un dictionnaire.
3. Après avoir lu le texte, comment peut-on comprendre le mot «
découvrir
»
?
A. Je vais utiliser mon dictionnaire.
B. Je vais demander à un ami français.
C. Je le comprends grâce à une image, une photo, ou un dessin.
D. Je le comprends grâce à la connaissance du vocabulaire.
4. Comment peut-on comprendre mieux un texte en langue étrangère selon l’auteur
?
A. Il faut traduire le texte mot à mot et deviner le sens des mots nouveaux.
B. Il faut comprendre les sens et leurs relations.
C. Il faut compter sur les mots pour leur donner le sens.
D. Il faut utiliser le dictionnaire pour comprendre tous les mots inconnus.
5. Quel est le meilleur titre du texte
?
A. Comment peut-on mieux comprendre un texte
?
B. Comment peut-on mieux utiliser un dictionnaire
?
4
�
C. Comment peut-on élever le niveau d’une langue étrangère
?
D. Comment peut-on mieux traduire un texte
?
Texte II
Partout en France, des citoyens luttent. Les uns se battent pour que les
éléments chimiques ne polluent plus leur eau courante, les autres pour que la
publicité ne les gêne pas. Certains font la grève de la faim pour que des enfants
trisomiques (先天愚型的) puissent aller à l’école, d’autres font tous les efforts
de sorte que les jeunes des quartiers difficiles ne tombent pas dans le crime. D’
autres encore luttent pour que les Français achètent leur café venu du Mexique à
un prix qui ne blesse pas les paysans. D’autres, enfin, font découvrir gratuitement
l’art contemporain sur une place parisienne.
Bref, ils sont loin des partis, ils se sont choisi des causes pour des buts
très précis. Généralement déçus par les partis politiques traditionnels – ce qui
ne veut pas dire qu’il ne votent pas - , ils préfèrent «
une cause concrète (具
体的), locale, mais toujours morale
», selon Jean-Louis Laville. «
La politique
?
Ils en font à leur manière, précise Anne Muxel, directrice au CNRS (Centre National
de Recherches Scientifiques). Simplement, la culture politique est en train de
changer. Les gens de politiques élus le voient bien, mais ils sont incapables devant
cette évolution.
» Un homme politique a bien résumé ce phénomène social
: «
Ces
gens braves ont enterré la politiques idéale des années 80, où tout paraissait
possible. Cet esprit de combat a une forte dimension morale. Ces citoyens-là ne
veulent pas vivre avec leurs seuls petits bonheurs privés.
»
1. Pour quoi ces citoyens luttent-ils
?
A. Pour leur intérêt local public.
B. Pour le monde entier.
C. Pour que leurs enfants malades puissent aller à l’école.
D. Pour que leurs peintures puissent être exposées sur la place.
2. Comment l’auteur nous a fait connaître ces citoyens-là
?
A. Il nous a cité en détail leurs activités quotidiennes et leurs discours.
B. Il nous a fait une comparaison entre les hommes politiques et ces citoyens.
5
�
C. Il nous a cité les commentaires des journaux et ses propres avis.
D. Il nous a présenté leurs activités et l’évolution de la politique en France.
3. Pourquoi l’auteur nous a-t-il cité autant de cas au début du texte
?
A. Parce qu’il veut nous présenter toutes leurs activités politiques et sociales.
B. Pour nous dire qu’ils luttent seulement pour leurs propres intérêts.
C. Pour nous dire qu’ils luttent à leur manière pour des buts précis.
D. Pour nous dire qu’ils s’intéressent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
4. «
La culture politique est en train de changer
», alors face à cette évolution,
quelle est l’attitude des hommes politiques
?
A. Certains hommes politiques l ’ ont bien observée, ils agissent pour leur
quartier.
B. Certains hommes politiques l’ont déjà prévue, mais ils n’ont pas le temps
de s’y préparer.
C. Certains hommes politiques l’ont vue depuis longtemps et ils sont prêts face
à l’évolution.
D. Ils l’ont bien comprise, mais ils n’y sont pas prêts.
5. Quelle phrase peut mieux résumer ce texte
?
A. Les Français ne veulent pas vivre avec leurs seuls petits bonheurs privés.
B. Les Français ne votent pas pour que leurs petits bonheurs privés.
C. Les Français ne luttent jamais que pour l’intérêt local.
D. Les Français participent aux activités politiques pour leurs petits bonheurs
privés.
Texte III
Les difficultés que connaît la presse écrite ne sont pas dues seulement à la
concurrence de la radio et de la télévision. Elles tiennent d’abord à ses conditions
d’exploitations, à des prix de revient et, pour la presse parisienne, à des frais
de distribution excessifs. Il s’y ajoute depuis quelques mois une baisse de recettes,
non de la publicité proprement dite, mais des petites annonces, due à une réduction
des offres d ’ emploi. La presse est de plus en plus exposée aux fluctuations
6
�
économiques ou politiques. Mais le paradoxe est là
: même dans les pays où l’
audiovisuel est beaucoup plus développé que dans le nôtre, la presse demeure à la
fois un moyen indispensable d’information et un support irremplaçable pour la
publicité.
La presse écrite a pour elle la permanence et le volume. Sait-on qu’un journal
télévisé tiendrait dans 3 colonnes d’un quotidien et peut-on connaître ou même
comprendre son époque en ne lissant qu’une demi-page de journal ? Sait-on qu’
on peut lire vingt-cinq mille mots à l’heure mais qu’on ne peut en entendre que
neuf mille
? On reçoit donc plus d’information en lisant qu’en entendant. Si
paradoxal que cela puisse paraître, un homme pressé et qui veut s’informer a
finalement plus d’intérêts à lire qu’à entendre.
1. Pour quelle raison la presse écrite connaît-elle des difficultés
?
A. La concurrence de la radio et de la télévision.
B. Ses conditions d’exploitations, des prix de revient.
C. La baisse de recettes, les fluctuations économiques ou politiques.
D. Il faut tenir compte de toutes les trois réponses précédentes.
2. Pour quelle raison la presse écrite parisienne est-elle plus touchée
?
A. A cause des forts coûts de la distribution.
B. A cause de la concurrence de la télévision.
C. A cause de la baisse des recettes de la publicité.
D. A cause des fluctuations économiques.
3. De quel paradoxe parle l’autre
?
A. L’audiovisuel tend à éliminer la presse écrite.
B. La presse écrite tend à éliminer l’audiovisuel.
C. La presse écrite continue à tenir une place importante face à l’audiovisuel.
D. L’audiovisuel continue à tenir une place importante face à la presse écrite.
4. Pourquoi la presse écrite demeure-t-elle indispensable et irremplaçable
?
A. Parce que l’audiovisuel n’est pas assez développé dans notre pays.
B. Parce que la presse écrite est permanente et fournit plus d’informations.
C. Parce que la presse écrite est mois chère que la presse audiovisuelle.
7
�
D. Parce que le journal télévisé est inséré de trop de publicités commerciales.
5. D’après l’auteur, _________________________.
A. le journal télévisé fournit un maximum d’informations en un temps réduit.
B. le journal télévisé suffit largement à informer celui qui veut comprendre
le monde.
C. l’homme pressé doit plutôt entendre les informations que les lire.
D. à temps égal, la lecture est plus profitable que l’écoute.
Texte IV
Le Chrysanthème
Rouge
: Je t’aime
Blanc
: Vérité
Jaune
: Amour fragile
Le Chrysanthème signifiait «
fleur d’or
» pour les Grecs. Il est vrai que l’
espèce sauvage ne porte que des fleurs jaune vif. Mais, les chinois et les Coréens
ont su de long date en cultiver toutes espèces, blancs, jaunes, violets, vieil or,
rouille (铁锈色的).
Le chrysanthème est une des fleurs préférées des Japonais et l’objet de grandes
fêtes lors de sa floraison. Il signifie là-bas
: paix et force d’âme dans l’
adversité.
En France, sa floraison qui se situe au moment de la Toussaint et du jour des
morts, en a fait la fleur préférée que l’on mette sur les tombes.
Autour de 1900, sous l’influence japonaise, il devint très à la mode à Paris
et Marcel Proust le fait figurer dans les appartements d’Odette. Aujourd’hui, il
perd sa réputation de fleur triste et participe à la décoration de nos intérieurs.
1. Pourquoi le chrysanthème signifiait-il «
fleur d’or
» pour les Grecs
?
A. parce que le chrysanthème est une fleur très précieuse pour les Grecs.
B. parce que le chrysanthème est très cher en Grèce.
C. parce que le chrysanthème sauvage ne porte qu’une couleur, jaune vif.
D. parce qu’on peut trouver le chrysanthème partout en Grèce.
8
�



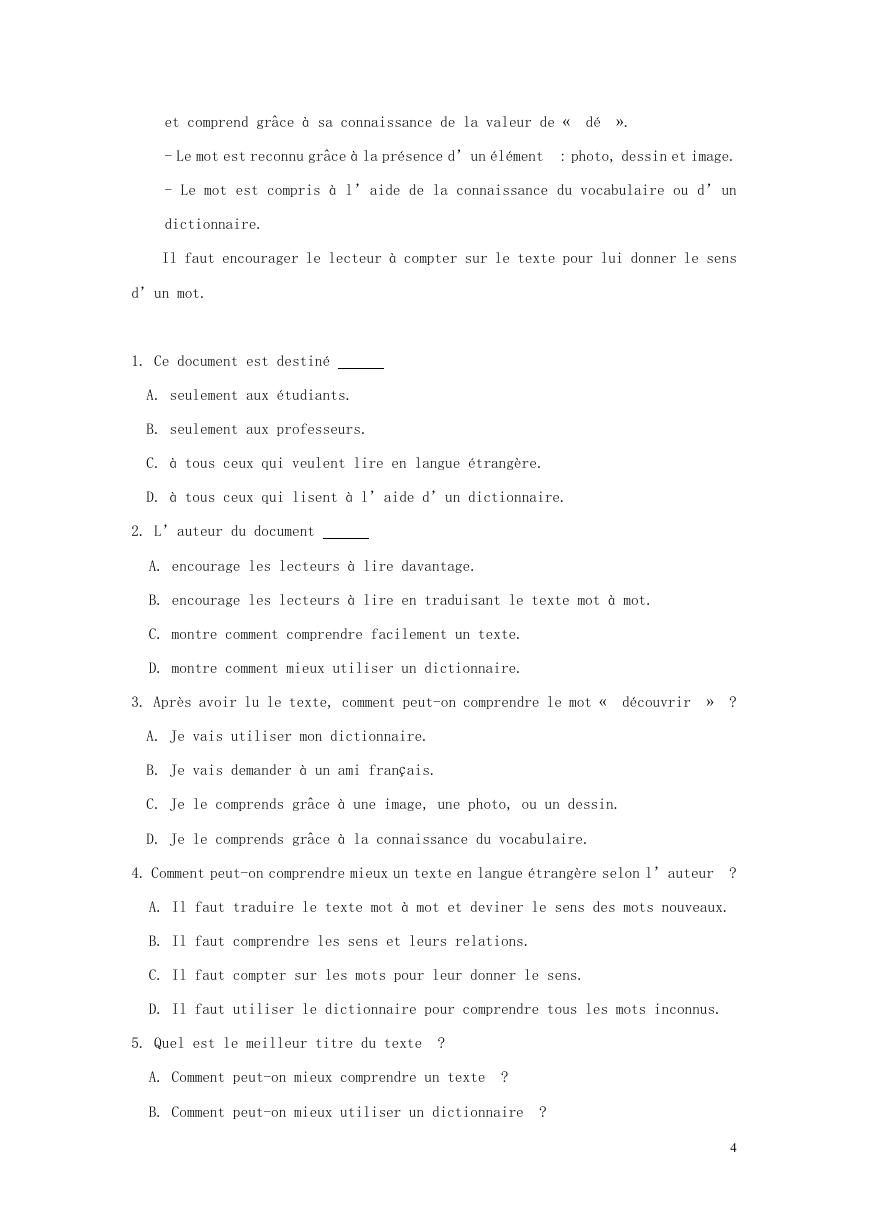
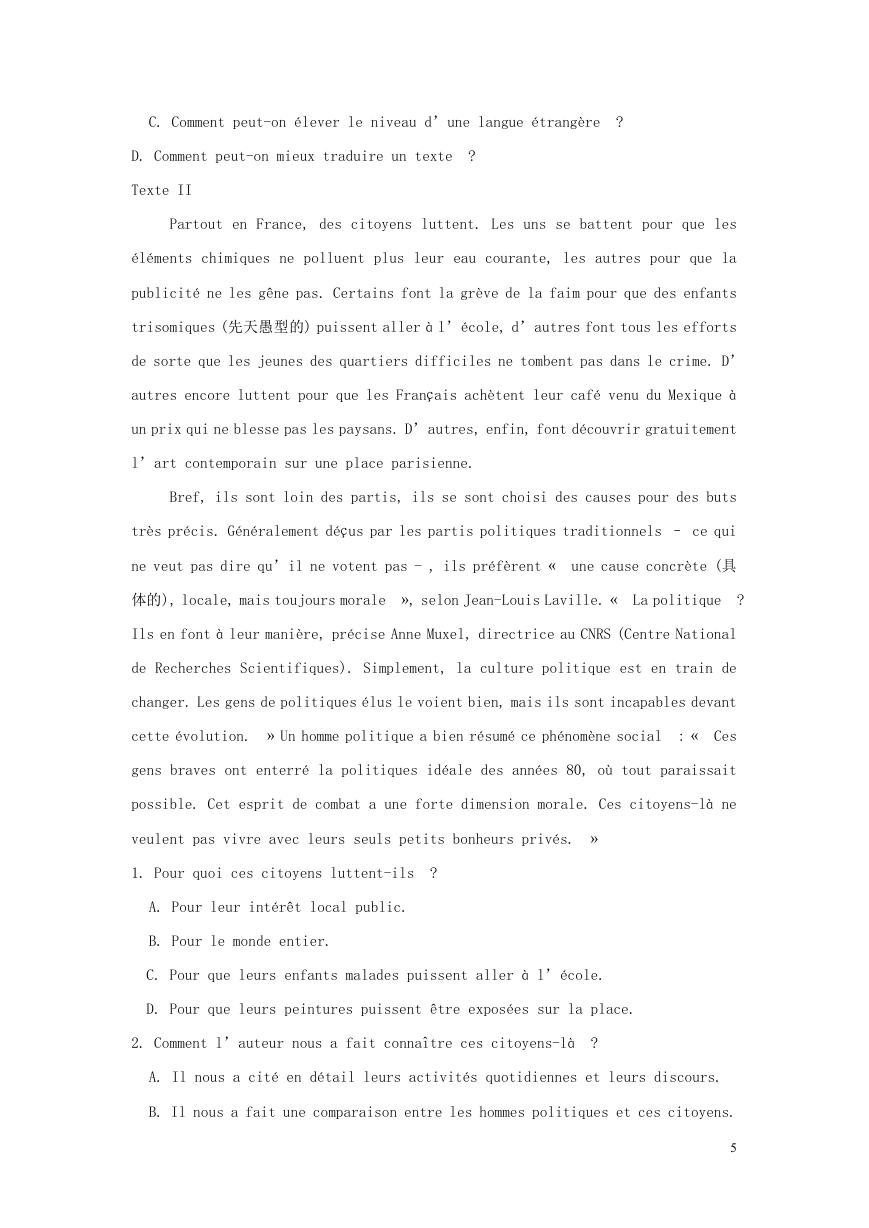
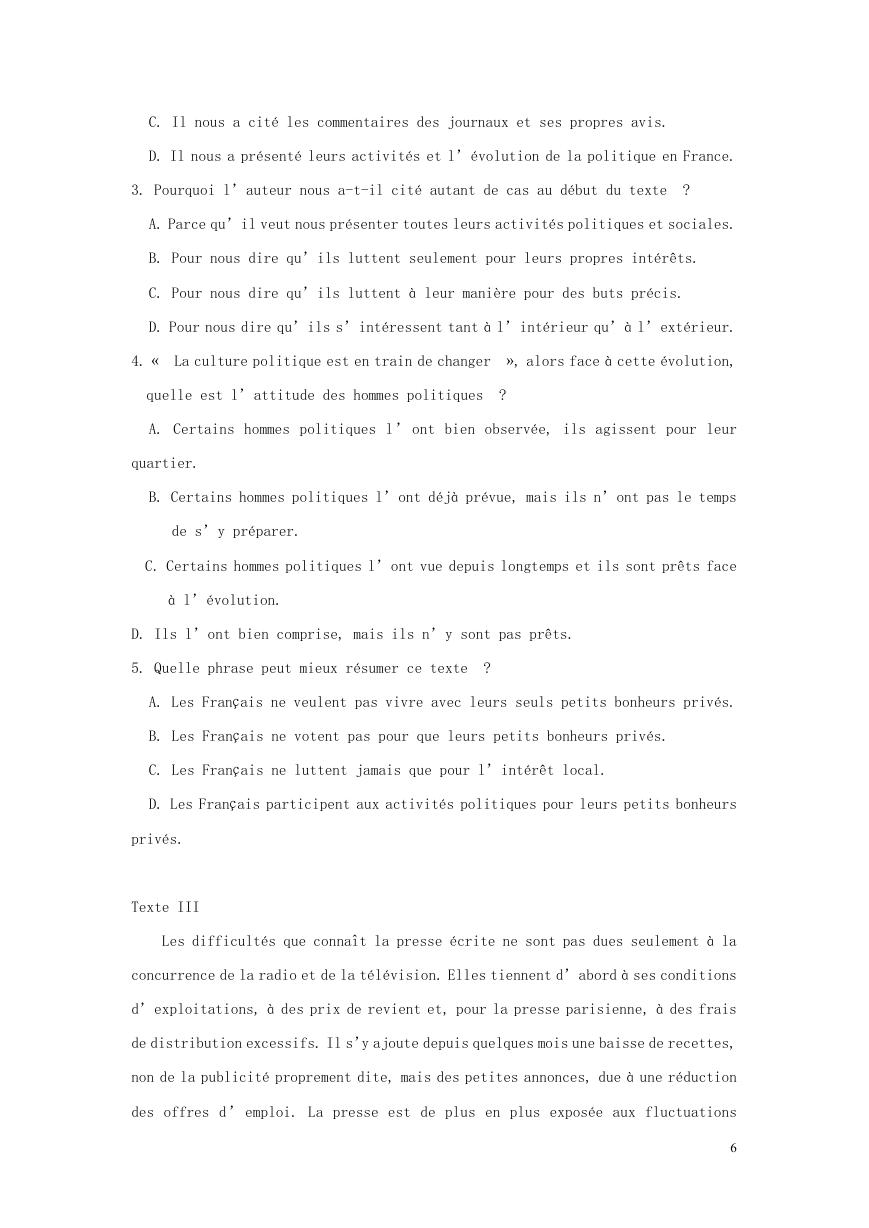
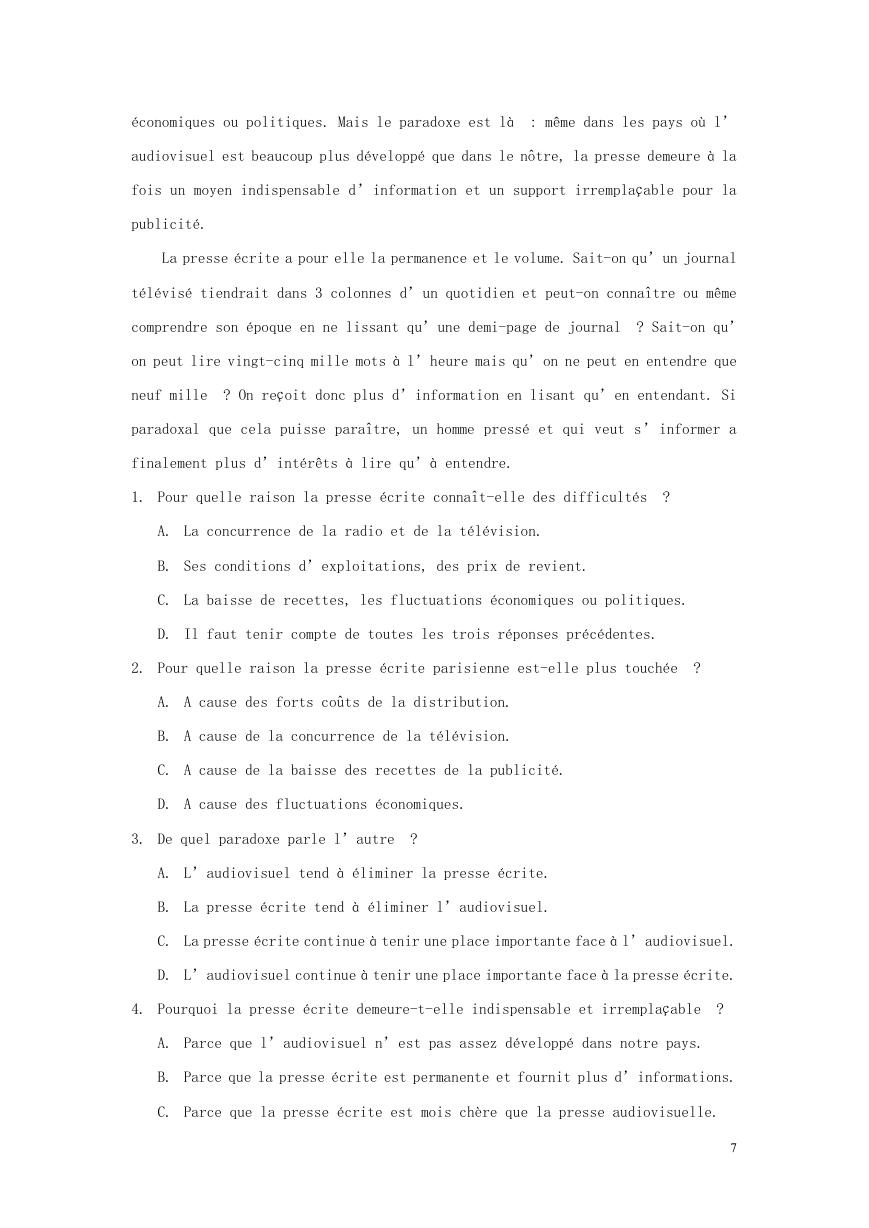
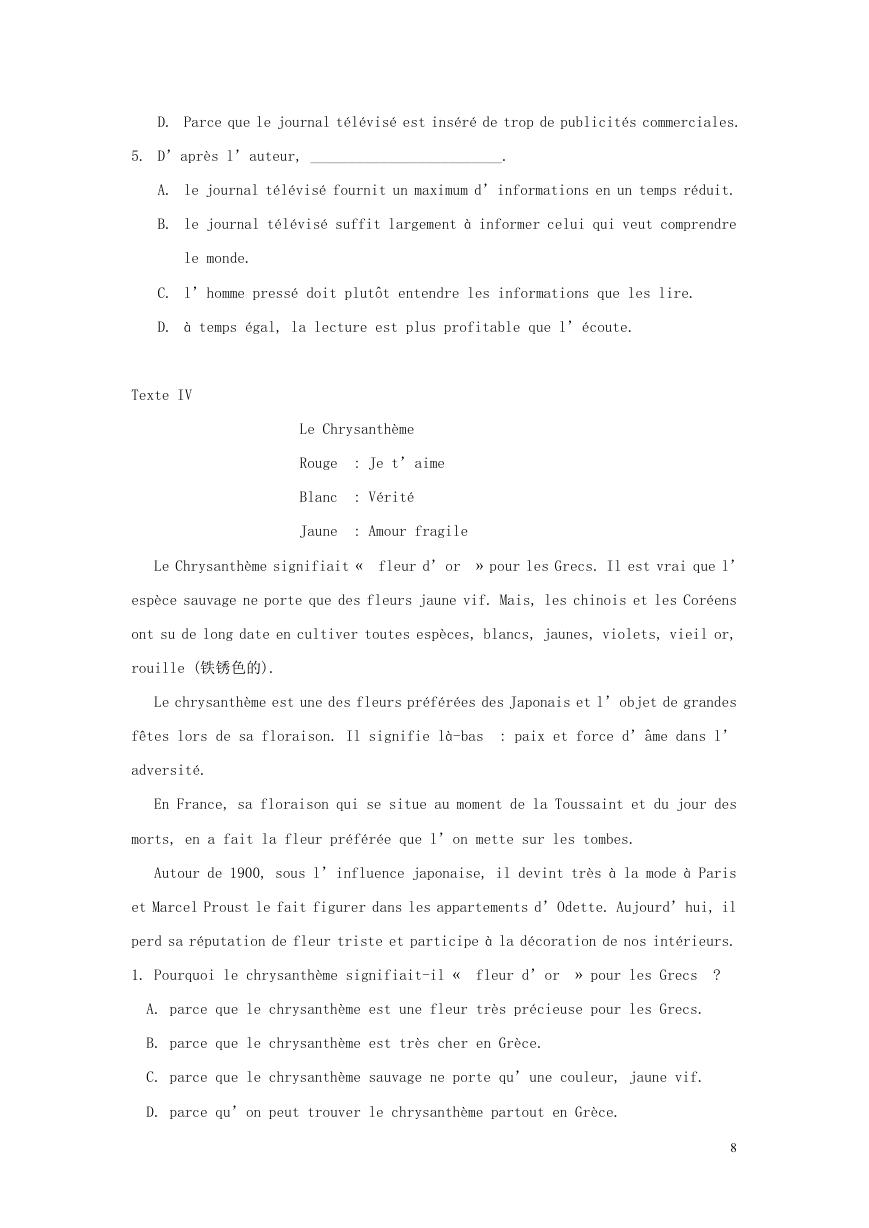



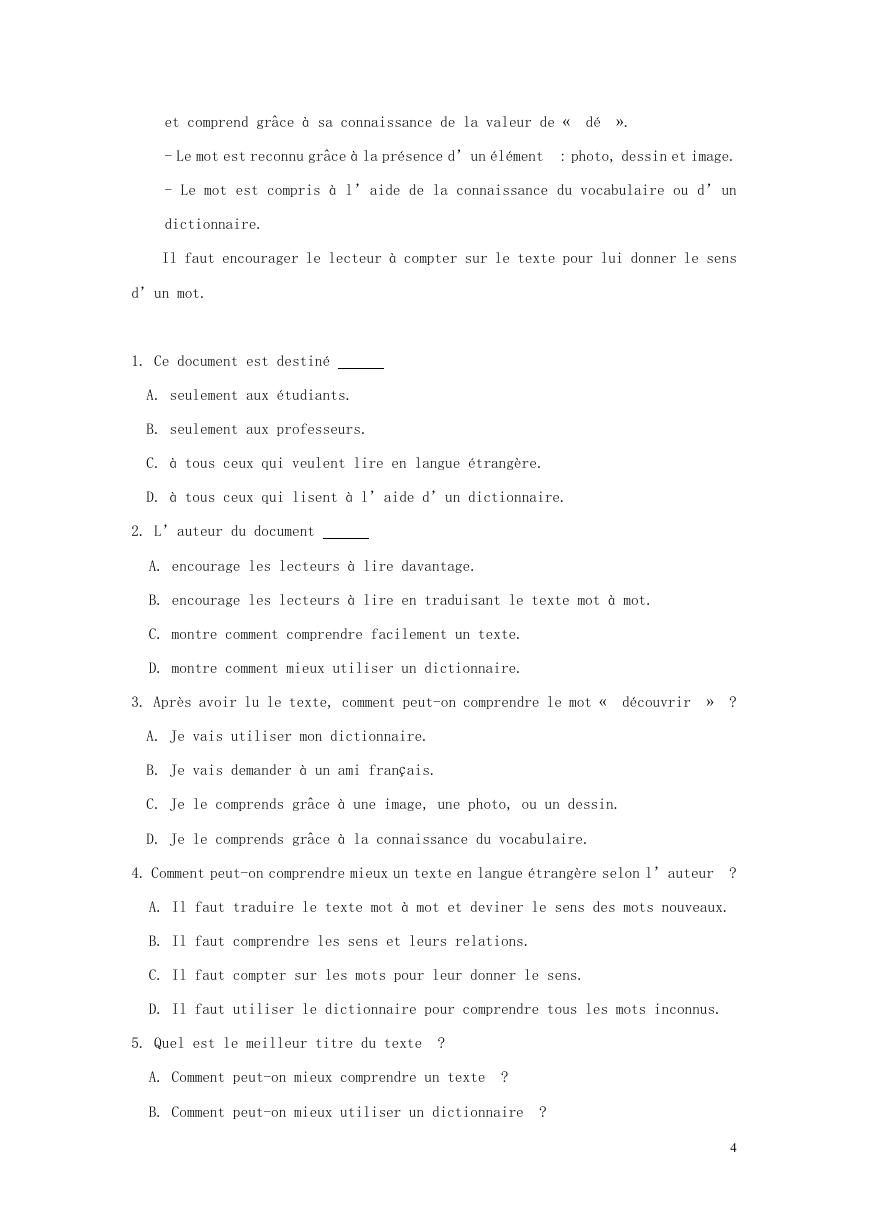
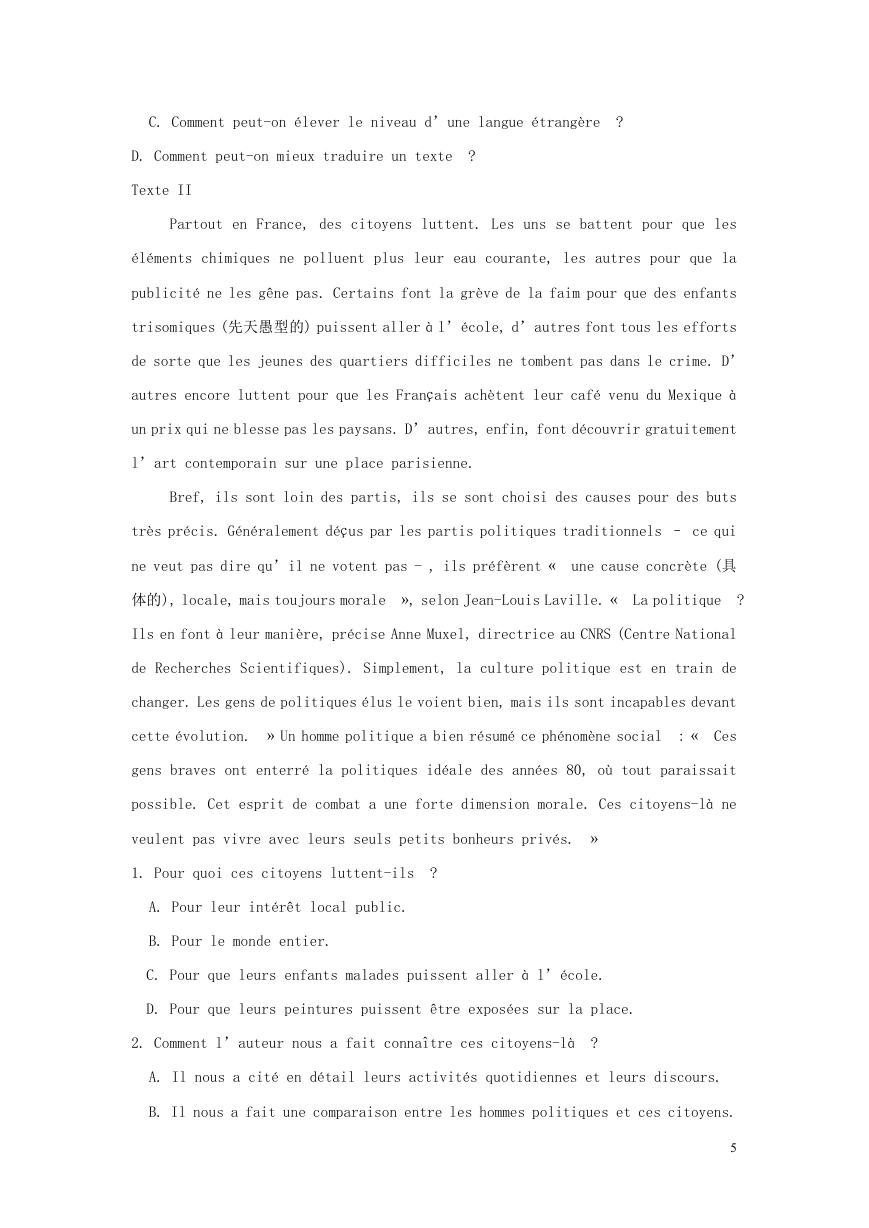
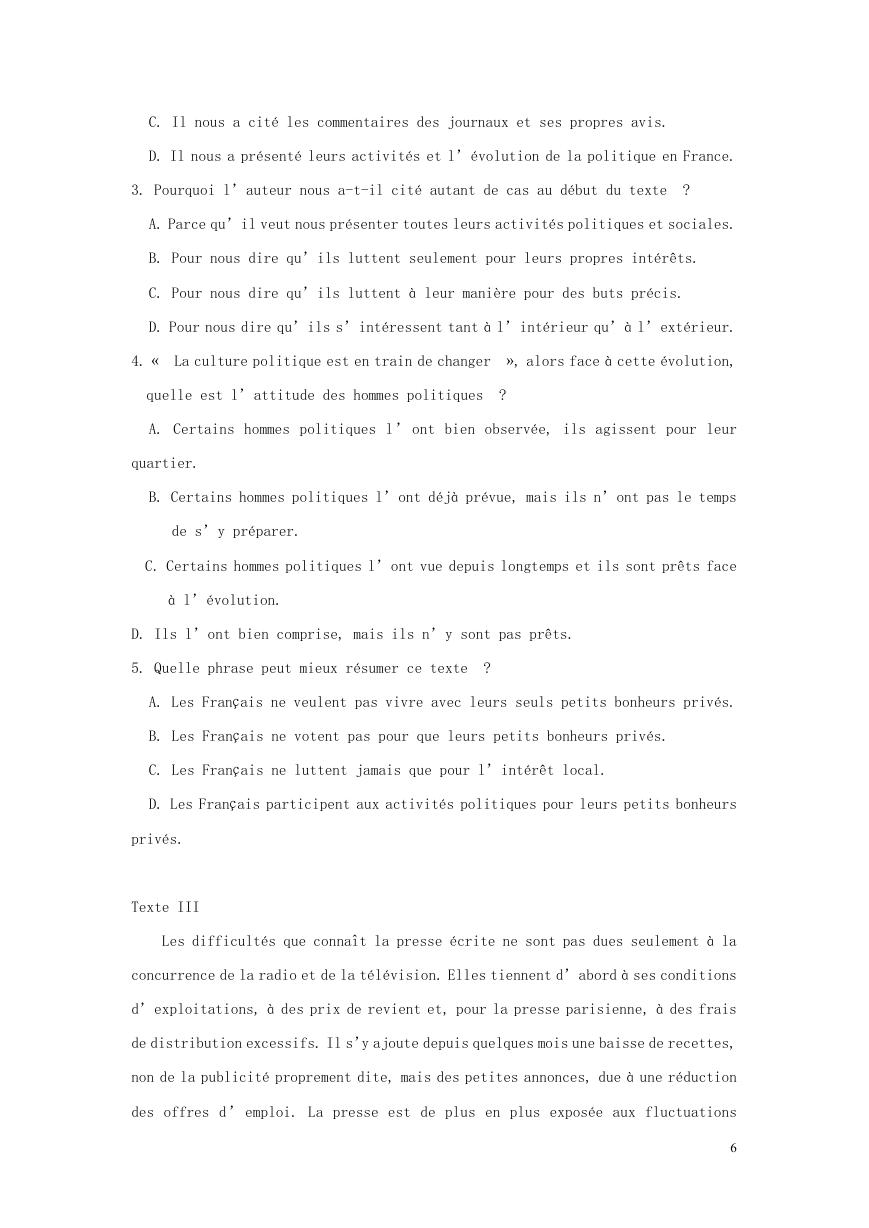
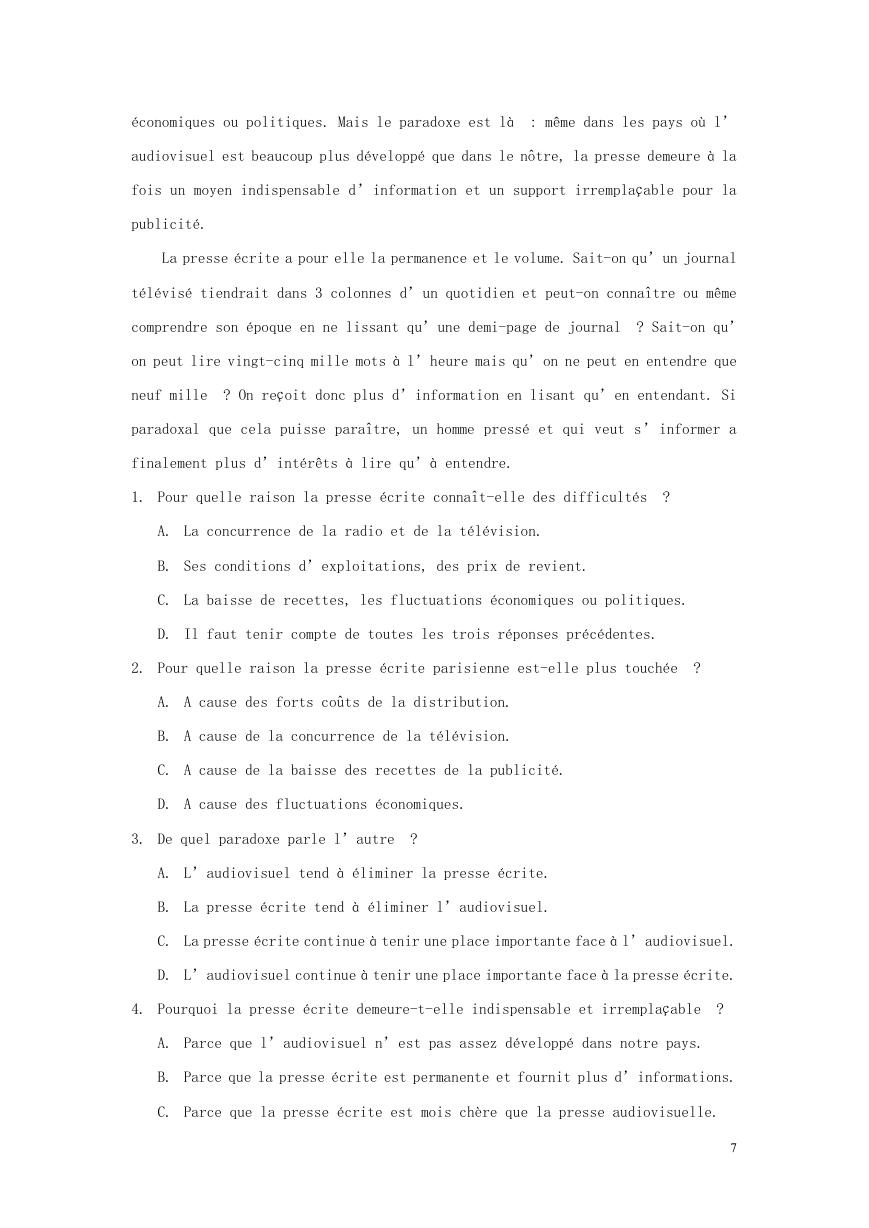
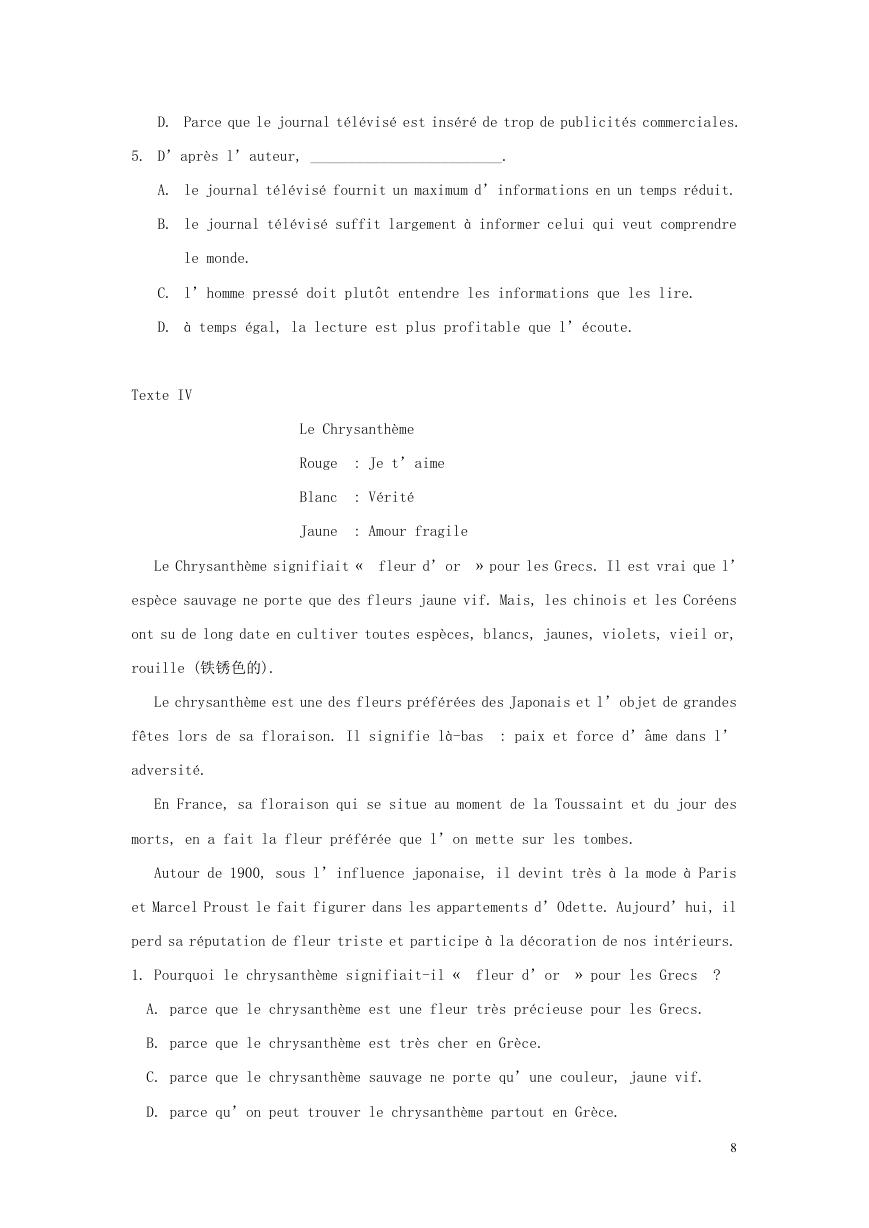
 2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc
2023年江西萍乡中考道德与法治真题及答案.doc 2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc
2012年重庆南川中考生物真题及答案.doc 2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc
2013年江西师范大学地理学综合及文艺理论基础考研真题.doc 2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc
2020年四川甘孜小升初语文真题及答案I卷.doc 2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc
2020年注册岩土工程师专业基础考试真题及答案.doc 2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc
2023-2024学年福建省厦门市九年级上学期数学月考试题及答案.doc 2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc
2021-2022学年辽宁省沈阳市大东区九年级上学期语文期末试题及答案.doc 2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc
2022-2023学年北京东城区初三第一学期物理期末试卷及答案.doc 2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc
2018上半年江西教师资格初中地理学科知识与教学能力真题及答案.doc 2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc
2012年河北国家公务员申论考试真题及答案-省级.doc 2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc
2020-2021学年江苏省扬州市江都区邵樊片九年级上学期数学第一次质量检测试题及答案.doc 2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc
2022下半年黑龙江教师资格证中学综合素质真题及答案.doc